Miaou, toc toc, ou encore boum… Ces sons familiers nous semblent simples. Pourtant, dans la langue japonaise, les onomatopées forment un système linguistique bien plus complexe et codifié. Omniprésentes dans le quotidien, les conversations ou les mangas, elles reflètent une perception sensorielle du monde unique. Bien plus qu’un simple effet de style, elles traduisent émotions, actions et ambiances avec une précision étonnante.
Une langue où les sons parlent
Les Japonais utilisent les sons pour décrire des sensations que nous n’exprimons pas toujours avec autant de richesse.
L'omniprésence des onomatopées dans le quotidien
Au Japon, les onomatopées ne sont pas réservées aux enfants ou aux bandes dessinées : elles font partie intégrante du langage adulte. Dans une conversation entre collègues, un reportage télévisé, ou même un message professionnel, il est courant d’entendre des expressions comme « gussuri » (profondément endormi), « shito shito » (bruine légère) ou encore « pera pera » (parler couramment).
Elles permettent de transmettre des nuances que le vocabulaire classique peine parfois à saisir. Elles sont aussi extrêmement utiles pour exprimer des sensations physiques, des climats ou des états d’âme avec un naturel déconcertant. Cela donne à la langue japonaise une capacité unique à incarner l’expérience sensorielle.
Une classification unique en 5 grandes catégories
Les onomatopées japonaises ne sont pas un fouillis sonore : elles sont classées de façon très rigoureuse. Cette organisation reflète le souci du détail et la recherche de précision caractéristiques de la culture japonaise.
Voici les cinq grandes catégories principales :
-
Giongo (擬音語) : onomatopées qui imitent des sons réels (bruits d’objets, de la nature, des animaux). Ex. : « wan wan » pour un aboiement.
-
Giseigo (擬声語) : sons produits par des êtres vivants (voix, cris, rires, pleurs). Ex. : « fu fu » pour un petit rire.
-
Gitaigo (擬態語) : expressions d’états, de mouvements ou d’attitudes qui ne font pas de bruit mais sont ressentis. Ex. : « doki doki » pour un cœur qui bat.
-
Giyougo (擬容語) : décrivent l’aspect visuel d’un objet ou d’une scène. Ex. : « kira kira » pour quelque chose qui scintille.
-
Gijougo (擬情語) : font écho à des émotions intérieures. Ex. : « ira ira » pour l’agacement.
Cette segmentation aide les Japonais à structurer leur pensée sensorielle de façon fine et nuancée.
Les gitaigo : un miroir des sensations humaines
Parmi toutes les catégories, les gitaigo sont particulièrement fascinantes. Ce sont des onomatopées qui expriment ce qui n'a pas de son perceptible.
Exprimer l'inexprimable par des sons
Imaginez décrire le stress avant un examen, l’énergie calme d’un animal en chasse, ou la légèreté d’un tissu en soie... Les gitaigo le permettent. Ces sons incarnent des mouvements internes, des humeurs ou des comportements invisibles.
Par exemple :
-
Doki doki (ドキドキ) : le cœur qui bat, symbolisant la nervosité ou l’excitation.
-
Zawa zawa (ざわざわ) : un murmure de foule ou une tension ambiante.
-
Pika pika (ピカピカ) : quelque chose de rutilant ou de très propre.
C’est un véritable langage des sensations. En une ou deux syllabes répétées, le locuteur transmet des impressions complexes de manière concise et efficace
Une langue profondément sensorielle
Les gitaigo témoignent de la tendance japonaise à valoriser l'observation, la réceptivité au monde et l’harmonie entre les êtres et leur environnement. Elles reflètent une manière de penser où les émotions et les sensations méritent autant d’attention que les faits ou les actions.
Dans la publicité, elles aident à créer des ambiances sensorielles. En littérature, elles plongent le lecteur dans l’état d’esprit des personnages. Elles sont donc à la fois outils expressifs, poétiques et mémotechniques.
Les onomatopées dans les mangas : un langage visuel à part entière
On les retrouve aussi intensément dans un support culturel emblématique : le manga.
Un code graphique universel pour les lecteurs japonais
Dans les mangas, les onomatopées sont dessinées dans le décor, parfois sans traduction ni bulle. Elles ne sont pas simplement lues, elles sont « ressenties » visuellement.
Le son « gyaa » (cri strident), le « bishi » (regard perçant), ou « goro goro » (tonnerre ou roulade) apparaissent souvent en grosses lettres stylisées, devenant partie prenante de la mise en scène. Le lecteur vit la scène dans sa dimension sonore autant que visuelle.
Cela contribue à la richesse narrative du manga, où le son devient vecteur d’ambiance et de rythme.
Une difficulté majeure pour la traduction
Pour les traducteurs, ces sons sont souvent un casse-tête. Les équivalents directs n’existent pas toujours, et traduire une onomatopée, c’est risquer de perdre la nuance ou la musicalité.
Exemple : shiin... exprime un silence pesant, quasiment « audible », que peu de langues peuvent restituer avec un tel impact. De même, gyuun évoque un effort physique concentré en une syllabe.
Certains éditeurs les laissent telles quelles, d’autres les adaptent selon le lectorat. Mais toutes ces décisions reflètent la richesse de la langue d’origine.
Onomatopées et culture populaire japonaise
Les onomatopées ne se limitent pas au papier : elles vivent dans la société japonaise contemporaine.
Dans les publicités, la mode, les réseaux sociaux
Les marques japonaises utilisent abondamment les onomatopées pour créer des images mentales :
-
Saku saku : pour un biscuit croustillant
-
Tsun tsun : pour une attitude boudeuse ou distante
-
Fuwa fuwa : pour décrire un coussin moelleux, ou un look pastel doux
Dans les vidéos TikTok japonaises, les influenceurs les utilisent à l’oral pour dynamiser leurs descriptions. Elles sont perçues comme amusantes, attachantes et efficaces.
Un reflet d'une culture de la nuance
La langue japonaise évite les affirmations brutes : elle préfère les nuances. Les onomatopées offrent une façon douce d’exprimer un ressenti. Dire « muka muka » (se sentir irrité) est plus implicite et socialement acceptable que d’accuser directement quelqu’un.
Elles permettent ainsi de transmettre des émotions tout en respectant les conventions sociales, la politesse et l’harmonie.
Vous l'aurez compris, les onomatopées japonaises sont bien plus qu’un simple ornement du langage : elles incarnent une manière de percevoir et de communiquer le monde. En s’intéressant à ces sons, on découvre une culture qui valorise la subtilité, l’intuition et la richesse sensorielle.
Apprendre à les comprendre, c’est accéder à une autre façon de penser, de ressentir, et de s’exprimer. Un monde où les sons parlent, même quand tout semble silencieux.
FAQ - Les onomatopées japonaises en bref
Les japonais utilisent-ils vraiment ces sons à l'oral ?
Oui, très fréquemment, même entre adultes, dans la vie de tous les jours.
Quelle est la différence entre giongo et gitaigo ?
Le giongo imite des sons réels ; le gitaigo imite des sensations ou états non sonores.
Est-ce que ces onomatopées existent aussi en français ?
Certaines oui, mais la langue japonaise en a des centaines, beaucoup plus nuancées.
Pourquoi y a-t-il souvent des répétitions comme "pika pika" ?
La répétition accentue l’intensité ou la continuité de l’action ou de l’émotion.
Peut-on apprendre ces mots en tant qu'étranger ?
Oui, et c’est même un excellent moyen de mieux comprendre la culture japonaise et ses subtilités.
















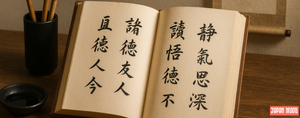




































Laissez un commentaire